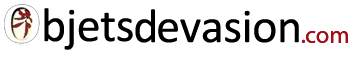Les peuples des hauteurs de l'Himalaya ont en commun avec ceux qui sont riverains du Gange des traditions religieuses comme le bouddhisme ou l'hindouisme, une forme d'association avec les spiritualités et autres croyances populaires déjà implantées. Si pour les uns, ce sont des traditions primitives chamaniques, pour les autres, ce sont des cultes animistes.
La forme du bouddhisme tibétain si particulière est issue de la religion traditionnelle Bön prébouddhique héritière ou non de cultes chamaniques.

Histoire de la tradition tibétaine bouddhiste : les bonnets rouges
C'est à partir du VIIème siècle que le bouddhisme tibétain se développe, il comprend les 3 évolutions du courant du bouddhisme primaire, Hinayana, Mahayana Grand véhicule et Vajrayana véhicule du Diamant. Vers 609 à 613 – 650, le roi du Tibet Songtsen Gampo qui avait fait prospérer son empire, étendit son pouvoir sur une grande partie de l'Inde, de la Chine et du Népal. Il fut alors le souverain à l'origine de la première diffusion du bouddhisme dans son pays. Néanmoins déjà à cette première époque, le bouddhisme tibétain fut influencé par le bouddhisme du Népal et de la Chine avec l'union du roi avec les filles des souverains de ces pays (la princesse népalaise Bhrikuti et Wencheng fille de l'empereur chinois).
Ce qui demeurera de cette histoire du premier roi religieux sera à jamais ancré dans la mythologie tibétaine :
- Le roi Songtsen Gampo est considéré comme une émanation de Chenresiggrand, plus communément Avalokitesvara, le bodhisattva le plus vénéré du Grand véhicule
- Les princesses népalaise et chinoise, ses deux femmes, sont considérées, comme les émanations de Tara blanche et de Tara verte (femmes de bodhisattva dans bouddhisme vajrayana et l'hindouisme, « libératrice ».
Un autre fait très remarquable de cette époque de la première diffusion du bouddhisme est la traduction des textes bouddhistes indiens vers la langue tibétaine par l'écriture alphasyllabaire tibétaine. Une invention du ministre Thonmi Sambhota du roi.
Vers 742 à 797 succéda le second roi Trisong Detsen qui lui aussi avait remporté un grand nombre de conquêtes militaires. Ce qui démarque le règne de ce second roi religieux du Tibet, ce sont ses hôtes de grandes importances : les plus grands maîtres indiens et chinois, dont Vimalamitra, Shantarakshita et Padmasambhava Guru Rinpoché du Tibet. À la demande du roi, Guru Rinpoché conduit les travaux de construction du premier monastère bouddhiste « Samye » (775).
À part quelques esquisses de ce qu'on appelait avant ce second règne le bouddhisme du Tibet, c'est véritablement sous l'influence du Guru Rinpoché que nait le lamaïsme ou bouddhisme tibétain. Pour cela, il unifie les cultes bonpos et la doctrine Vajrayana (vers 750).
C'est une véritable révolution qui s'opère avec la construction de temples au Tibet puisque des Tibétains furent ordonnés moines pour la première fois et le bouddhisme devient une religion d'État. Il fonda l'ordre Nyingmapa des Tibétains moines de la communauté des Bonnets rouges (la Lignée des Anciens, rejoints des siècles après par les ordres Kagyupas, Karmapas et Sakyapas (avec la coiffe et la robe rouges). La communauté blanche est composée de laïcs.

Ainsi avec le lamaïsme, toutes les couches de la société tibétaine furent touchées par cette religion qui souvent se confond avec la culture.
Tri Ralpachen fut le troisième roi religieux jusqu'en 838 qui marqua l'histoire du Tibet en nouant des relations pacifiques avec la Chine (Traités). À cette époque, la relation entre bön et bouddhiste atteint des seuils élevés critiques sous forme de rivalités politiques. Son frère Langdarma non partisan du bouddhisme, assassine le roi et persécute par la suite les moines. Il efface de son royaume toutes les traces d'institutions bouddhiques, mais il meurt assassiné par le moine yogi Lhalung Palgyi Dorje (842 ou 846).
Qui est Guru Rinpoché du Tibet?
Associé à l'émanation d'Amitabha dans les Etats himalayens de l'Inde, il est vénéré comme le second Bouddha » au Tibet (mais aussi au Bhoutan et au Népal). Même selon la mythologie de ces pays, Bouddha Shakyamuni et Padmasambhava ne font qu'un ! Ils sont complémentaires, Bouddha représente l'aspect exotérique du Bouddhisme et Padmasambhava l'aspect ésotérique. Padmasambhava est à l'origine de la tradition terma ou Trésors spirituels.
La légende raconte que Padmasambhava est né sous l'apparence d'un enfant de 8 ans enveloppé dans une fleur de lotus flottant sur le lac Dhanakosha dans le royaume d'Oddiyana du Gandhara. Une autre légende raconte qu'il survécut à la tentative de son assassinat sain et sauf en émergeant du bûcher en un lac appelé Rewalsar ou Tsopéma.
La renommée de ce Maitre fut bâtie dans son pouvoir de compréhension et de mémorisation des textes ésotériques après juste une seule lecture ou écoute. Une réputation qui allait s'étendre jusqu'au Tibet. Le roi Trisong Detsen dont son royaume fit assailli par des déités malfaisantes de la montagne fit appeler Padmasambhava pour utiliser ses pouvoirs. C'est alors par son habileté et son génie que le Guru Rinpoché réussit à soumettre ces déités conformément aux principes tantriques, les réorientant vers la pratique du dharma. À la suite de cette expérience, il fonde le premier monastère du pays Samyé Gompa pour répondre le bouddhisme tantrique au Tibet. En présent, le roi Trisong Detsen offrit sa femme Yeshe Tsogyal à son hôte, ce qui irrita les ministres du roi restés fidèles à la religion Bön.
il fut injustement accusé du meurtre d'un ministre du roi. Comme sanction, il fut banni de la cour et décida de vivre entre les cimetières pour mener une vie d'ascèse et de pratique du yoga.
Division du Tibet, seconde diffusion du bouddhisme et tutelle mongole
Après l'assassinat du meurtrier du roi Tri Ralpachen, le Tibet fut le théâtre de violences sans pareil entre ses successeurs. Cette lutte affaiblit le pouvoir et le divisa en petites royautés. Mais le bouddhisme tibétain survit au Tibet Oriental. D'autre part, des moines persécutés par le pouvoir de Langdarma avaient trouvé refuge au nord du Tibet. Ces derniers formèrent des lignées de disciples auxquels ils transmirent leur savoir. C'est en nombre plus important et avec un climat apaisé que ces moines du nord revinrent au Tibet central pour rénover les institutions monastiques.
Le roi Yeshe-Ö du Ngari (Tibet occidental) fit venir d'Inde des maitres et artistes de haute importance :
- le célèbre traducteur et bâtisseur Rinchen Zangpo initiateur des 108 temples le long du fleuve Sutlej
- le maitre Marpa et son célèbre Milarépa
- Atisha célèbre maitre fondateur du bouddhisme Kadampa était venu au Tibet en 1042 pour y enseigner les instructions du Bouddha.
La vague de renouveau du bouddhisme tibétain est alors remarquée dans les terres centrales et occidentales au Xème siècle, ces artistes et maitres rapportent d'Inde des enseignements bouddhistes qui favorisent la naissance de nouveaux courants de pensée et de plusieurs écoles.
Deux siècles plus tard (au XIIème siècle), le chef Genghis Khan des Mongols grand conquérant de l'Asie va établir une relation chapelain-protecteur (Chö-yon) avec les Sakyapas. À cette époque au Tibet il n'y avait pas de pouvoir central et les lamas partagent le pouvoir avec les souverains du royaume (par exemple les lamas des branches Kagyupa avec les souverains tangoute). Avant cet accord, en 1207 les attaques mongoles inquiètent les tenants du royaume tangoute. Les monastères des terres centrales envoient alors des porte-paroles pour rencontrer Gengis Khan et lui faire part de la soumission du royaume évitant le risque d'attaque. Ce fut le moine Tsangpa Dunkhurwa de la lignée Tsalpa Kagyu accompagné de ses 6 disciples qui accomplit cette mission, mais cela ne servit qu'à retarder le déclin du royaume.
En 1240, le général Doorqa Darqan envoyé par le chef des Mongols parvint à 80 km de Lhassa. Coup du sort, l'abbé Sakya Pandita du monastère de Sakya fit convoquer en 1244 à la cour du général grâce à sa renommée. En 1249, le pouvoir sur les provinces de l'Ü-Tsang lui est confié, marquant le partenariat politico-religieux entre Sakyapas et Mongols.
Par la suite deux clans s'opposèrent : celui de Kubilaï Khan petit-fils du premier conquérant mongol aidé des Sakyapas, son frère lui aussi héritier mongol petit-fils de Genghis Ariq Boqa aidé de Karma Pakshi. Kubilaï Khan chercha d'abord le soutien du chef Karma Pakshi de la lignée Kagyu (grande tradition contemporaine du bouddhisme tibétain) qui le lui refusa.
De cette grande rivalité l'héritier Kubilaï Khan sort vainqueur en 1264 : il fonda la dynastie Yuan (1271-1368) confiée plus tard à Phagpa, neveu de Sakya Pandita âge de 20 ans. Bien des péripéties plus tard et avec l'avènement de la dynastie chinoise Ming, le Tibet est définitivement débarrassé de la tutelle mongole et devient indépendant.
Bonnets jaunes, moines et lamas
Une nouvelle école voit le jour avec le réformateur Tsongkhapa qui va placer la discipline monastique au premier rang. Il va rassembler en un seul canon unique tous les éléments essentiels des enseignements bouddhiques. Cet ordre est appelé Gelugpas la Lignée des moines vertueux (Bonnets jaunes, robe et coiffe jaunes). Parmi les grands évènements marquants de cette période, on retiendra la construction des plus imposantes universités monastiques, Ganden, Drepung et Séra.
Entre Bonnets jaunes et Bonnets rouges (Karmapas) d'importantes rivalités éclatent : les Mongols convertis au Bouddhisme vont y mettre rapidement un terme en conférant à Sonam Gyatso (troisième successeur de Tsonkhapa) le titre de Dalaï-lama (océan de sagesse) en 1578. À la fin du XVIème siècle, le courant Gelugpa domine politiquement au Tibet, facilité par la conversion au bouddhisme tibétain du chef des Mongols Altan Khan (Dalaî-lama Sonam Gyatso fut l'hôte en Mongolie du chef qui se convertit après le second voyage du Dalaï-lama).
Le 1er Dalaï-lama fut un disciple du réformateur Tsongkhapa, Gendun Drub, le second Dalaï-lama dans l'histoire du Tibet sera sa réincarnation en la personne de Gendun Gyatso. Tsongkhapa lui-même fut ordonné moine novice à 7 ans et sera formé à la tradition kadampa, il adopta le bonnet jaune, couleur des origines du Bouddhisme indien. Le 3ème sera la réincarnation du second.
Le 4ème par contre fut l'arrière-petit-fils du chef des Mongoles converti. L'indépendance du Tibet sera proclamée en 1913 par le 13ème Dalaï-lama. La fin de l'autorité politique et religieuse du dalaï-lama sur le Tibet a sonné en 1949 avec le Parti communiste chinois de Mao Zedong.
Dans le paysage tibétain, la Chine imposa que le pouvoir du Dalaï-lama disparaisse (Accord en 17 points sur la libération pacifique du Tibet de 1951). C'est la révolte tibétaine de Lhassa 1959 opposée à la présence chinoise qui va contraindre le Dalaï-lama à s'exiler en Inde.
Cet exil entraîne une fracture du bouddhisme tibétain avec sa terre natale, s'en suit une large diffusion à travers le monde.

Actuellement, le bouddhisme tibétain se retrouve après un renouveau en Chine (dans les régions autonomes du Tibet et de Mongolie), dans les provinces de Qinghai, de Gansu, de Yunnan et de Sichuan et dans des grandes villes (temple de Yonghe de Pékin, temple Guangren de Xi'an). On retrouve également la pratique dans des républiques de Russie et parmi les régions de l'Himalaya (Népal septentrional, Inde avec les Etats de Sikkim, d'Arunachal Pradesh, Jammu-et-Cachemire, d'Himachal Pradesh, districts de Lahaul et Spiti.
Au Bhoutan dont le bouddhisme tibétain est devenu religion d'État.
Parmi les grandes Écoles du bouddhisme au Tibet, Il y a 4 grandes lignées dont : la tradition Nyingmapa (plus ancienne) qui se base sur la méditation, l'école Kagyüpa sur la transmission orale, celle du courant Sakyapa prône l'ascétisme et la lignée Gelugpa le savoir.
L'école Gelugpa est la plus récente des quatre lignées du bouddhisme tibétain dont le dalaï-lama fait partie du clergé de cette école. II est la première autorité spirituelle du Tibet. La tradition Gelug se base des éléments du Kadampa du maitre indien Atisha. Ce courant impose dans la philosophie et les sutras la formation et les pratiques tantriques.
En effet dans la conception même du bouddhisme tibétain ou tantrique, les paroles du Bouddha Gautama figurent dans les plus anciens textes ésotériques hindous (Tantras). Cette branche du Bouddhisme se distingue également par le strict célibat des moines et des moniales dans une optique de monachisme.
Les textes tantriques ne pouvant pas être saisis par tous, on fait appel à un grand maître religieux appelé Lama (pas nécessairement moine et peut se marier). Toutefois, il bénéficie d'un grand prestige dans la communauté. Il revient au lama de former ses disciples pour approfondir ses connaissances et pour que celui-ci puisse maîtriser les techniques tantriques.
Cette discipline qui penche entre rituels et cultes réunit plusieurs techniques magiques de canalisation d'énergie (conférant des pouvoirs surnaturels au pratiquant) pour atteindre plus rapidement la Boddhi. Ces techniques sont associées à des objets de culte :
- statue de Bouddha
- mala
- bols chantants
- cloches ghanta
- dorje ou vajra (diamant et foudre)
- moulin à prières (avec des mantras).

Ces objets de culte permettent non seulement de favoriser la méditation, mais également d'apporter une aide aux pratiquants pour saisir les notions abstraites du tantrisme.